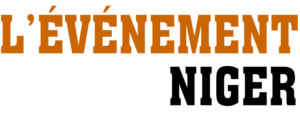Prescrite en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, dans la plupart des pays africains, au Proche-Orient et dans certains pays d’Europe, l’HCQ est déclarée dangereuse voire mortelle par les autorités françaises. Et les journalistes suivent. L’affirmation ne résiste pourtant pas à l’analyse. Connus de très longue date, les effets secondaires sont bien contrôlés à l’IHU de Marseille.
Épisode 12
Le 5 mars 2020, dans un « Avis relatif à la prise en charge des cas confirmés d’infection au virus SARS-CoV2 », le Haut Conseil de la santé publique (Direction générale de la Santé) indiquait que « on ne dispose pas à ce jour de données issues d’essais cliniques évaluant l’efficacité et la sécurité d’options thérapeutiques spécifiques dans la prise en charge des infections ». Toutefois, se référant à des recommandations d’un comité de l’OMS datées du 24 janvier 2020, il faisait déjà un choix : « le traitement spécifique à privilégier selon une approche compassionnelle est le remdesivir » (le très coûteux médicament du très influent laboratoire pharmaceutique américain Gilead). Et dans les médias, certains caciques de l’administration sanitaire (à l’instar du directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch, dès le 1er mars) déclaraient déjà que le traitement différent proposé par le professeur Raoult (IHU de Marseille) ne servait à rien et qu’il était dangereux.
Ainsi, avant même la constitution du Conseil scientifique chargé de la gestion de la crise du Covid, le 11 mars, le choix du ministère de la Santé était déjà fait. La sécession de Raoult s’éclaire d’un jour nouveau. Et l’on comprend mieux comment est arrivé dans le débat l’argument de la dangerosité cardiaque de l’hydroxychloroquine.
Le ministère de la santé donne le La
La suite est connue. Constatant cette mise à l’écart et après sa mise en retrait du Conseil scientifique, D. Raoult lance sa propre communication par vidéo le 5 mars, date à laquelle son équipe teste encore différentes combinaisons d’anti-virus et d’antibiotiques en s’inspirant notamment des recherches chinoises signalées 10 jours plus tôt, puis annonce son protocole définitif et ses premiers résultats le 16 mars. L’IHU teste alors déjà environ 600 personnes par jour.
Face au succès populaire que rencontre Raoult, la riposte générale s’organise au ministère. Le 27 mars, l’Agence Nationale de Sécurité du médicament communique sur la dangerosité cardiaque potentielle des composants du protocole marseillais, aussitôt relayée par la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique (« l’emploi de ces médicaments [hydroxychloroquine et azithromycine], en particulier en association, fait courir des risques d’effets indésirables graves, en particulier cardiaques. Plusieurs cas viennent d’être rapportés aux Centres Régionaux de Pharmacovigilance ») et le Réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance (« la chloroquine, l’hydroxychloroquine (mais aussi l’azithromycine et le lopinavir, à un moindre degré) bloquent les canaux potassiques hERG. Les patients recevant concomitamment ces traitements sont exposés à des prolongations possibles de l’intervalle QT corrigé (QTc) de l’électrocardiogramme de surface. La toxicité cardiaque de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine est dose-dépendante et des cas d’arythmies graves ont été rapportés lors de surdosage mais aussi à dose thérapeutique »). Enfin, les Agences Régionales de Santé (ARS) relayaient localement.
Toutes les agences du ministère de la Santé dégainent donc l’artillerie lourde pour éteindre l’incendie allumé par Raoult. Et la presse médicale comme la presse généraliste vont suivre presque comme un seul homme la communication gouvernementale. A ce moment-là, les 3 seuls décès suspects signalés dans le réseau régional de pharmacovigilance (en l’occurrence celui de Nouvelle-Aquitaine) sont pourtant des cas d’automédication (signalés par exemple par Sud-Ouest). Rien à voir avec la prescription médicale dont le dosage comme les effets sur l’évolution clinique des malades sont contrôlés par les médecins. Aucun de ces communiqués (et aucun des articles de presse qui les relayeront) ne rappelle en outre que les effets indésirables graves de l’hydroxychloroquine, connus de longue date (on y reviendra), surviennent essentiellement dans les traitements de longue durée de certaines maladies graves, tandis qu’il est ici question d’un traitement de quelques jours. Mais qui se soucie de tous ces « détails » ?
Quand Le Monde travaille à charge
Après une première salve d’articles de presse à la fin du mois de mars, le 9 avril c’est Le Monde qui relance le sujet avec un article de Sandrine Cabut intitulé « Coronavirus : les effets indésirables graves s’accumulent sur l’hydroxychloroquine ». Dès la première phrase, le ton est donné : « l’hydroxychloroquine (Plaquenil), seule ou associée à l’antibiotique azithromycine, n’a toujours pas démontré son efficacité chez des patients atteints du Covid-19, mais les signaux de pharmacovigilance s’accumulent ». Les faits seraient les suivants : « depuis le 27 mars, 54 cas de troubles cardiaques dont 7 morts soudaines ou inexpliquées (3 de ces personnes ont pu être sauvées par choc électrique) relatifs à ces médicaments ont été analysés au centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Nice, chargé de la surveillance nationale des effets indésirables cardiaques des médicaments évalués dans l’infection au nouveau coronavirus ». Dans 36 des 54 cas, il s’agirait d’une altération du rythme cardiaque (le fameux « allongement de l’espace QT »).
La journaliste a téléphoné au professeur Milou-Daniel Drici, responsable du CRPV de Nice, qui explique que « quand il s’agit de molécules comme des anticancéreux, le rapport bénéfice/risque reste positif. Dans le cas de l’hydroxychloroquine, le bénéfice n’est pas prouvé et le risque est avéré. La prescription ne devrait pas se faire en dehors d’essais cliniques ». Elle conclut que « le spectre d’un accident cardiaque est l’une des raisons pour lesquelles les autorités de santé ont réservé le traitement hydroxychloroquine et azithromycine aux patients hospitalisés ».
Enquête du quotidien le plus célèbre de France ou exercice de traduction vers le grand public de la communication gouvernementale ? Par naïveté ou en service commandé de sa rédaction en chef ? Ces questions se posent malheureusement. En effet, l’article souffre d’une quadruple carence d’analyse :
1- Savoir compter. Combien y-a-t-il eu de morts ? L’article dit « 7 morts » mais « 3 ont pu être sauvé » (sic !). Donc 4 morts et non 7. L’article précise : « depuis le 27 mars ». Or le précédent bilan de pharmacovigilance qui annoncé 3 morts par automédication date du 29 mars. Se pourrait-il qu’il n’y ait en réalité que 1 mort supplémentaire depuis cette date ? Le communiqué de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) du 10 avril le confirmera : il y a eu en tout et pour tout 4 décès « en lien avec des médicaments utilisés chez des patients infectés par le COVID-19 ». Et ce, sans que l’on sache du reste si le médicament en cause est l’hydroxychloroquine ou/et le lopinavir (de même que les rapports de pharmacovigilance n’indiquent rien au sujet des associations de médicaments).
2- Savoir estimer la valeur d’une information. Si tous ces décès sont le fait de personnes qui se sont auto-médiquées, en quoi cela constitue-t-il une information pertinente pour comprendre le problème posé ? Tout surdosage de médicament est potentiellement dangereux voire mortel. C’est un truisme. En 2019, une équipe de chercheurs australiens a montré que près de 100 000 hospitalisations et plus de 200 morts ont été causé dans ce pays de 25 millions d’habitants au cours des dix dernières années par simple abus de paracétamol. Et, en France, un collectif de médecins estimait par ailleurs en 2018 que le mauvais usage des médicaments était probablement responsable d’environ 10 000 morts en France chaque année. La question qui est posée ici est celle de l’usage d’un médicament sur prescription médicale, dans un contexte précis et avec des dosages précis. Soit l’information est liée à cet usage et alors elle est intéressante, soit elle n’a rien à voir et alors elle n’a aucun intérêt.
3- Savoir interpréter les chiffres. Si on constate 1 mort pour 100 patients traités avec un médicament, alors on a un taux de mortalité de 1%. Mais combien de patients ont été traités avec l’hydroxychloroquine en mars 2020 ? Les données de l’assurance-maladie l’indiquent clairement : la délivrance sur ordonnance a augmenté de 145% durant la deuxième quinzaine de mars. « Nous estimons à environ 28 000 le nombre de personnes supplémentaires ayant acquis sur ordonnance un traitement d’hydroxychloroquine (ou plus rarement de chloroquine) sur les semaines 12 et 13 de 2020 », écrit le rapport public (page 11). Si l’on constate 1 mort pour 28 000 patients traités avec un médicament, le taux de mortalité n’est plus du tout de 1% mais de 0,0035%. Et il est même beaucoup plus faible encore car il s’agit ici de 28 000 « personnes supplémentaires ». Auxquelles il faut y ajouter toutes celles qui achetaient déjà et continuent à acheter en pharmacie de l’hydroxychloroquine pour d’autres maladies que le Covid : environ 1 500 personnes par jour (hors dimanche) en janvier 2020 (ibid., page 13), soit environ 45 000 personnes par mois (les ordonnances se renouvèlent tous les mois). La base de calcul du taux de mortalité se situe donc plutôt entre 70 et 75 000. Et ceci ne compte pas les dizaines de milliers de voyageurs. Au final, le taux de mortalité est donc insignifiant.
4- Ne pas manipuler les sources. L’informateur du Monde est donc le CRPV de Nice, ce qui est logique puisque le CRRPV de Dijon a été chargé par l’ANSM de « recenser l’ensemble des effets indésirables déclarés dans la base nationale de pharmacovigilance », tandis que celui de Nice a été chargé de « réaliser une enquête complémentaire portant spécifiquement sur les effets cardiovasculaires de ces traitements ». Le quotidien local Nice-Matin l’avait du reste déjà annoncé une semaine plus tôt, le 1er avril, publiant une interview du Dr Drici. Ce dernier s’y montrait beaucoup plus circonspect et démentait les informations alarmistes déjà distillées dans la presse :
« Question : confirmez-vous cette information de nos confrères du Point selon laquelle des effets toxiques cardiaques et même des décès auraient été recensés chez des personnes ayant pris de l’hydroxychloroquine ?
Réponse : L’auteur de l’article auquel vous faites référence dit tenir ses informations d’un pharmacien correspondant d’un centre de pharmacovigilance. Or tout le réseau français nous redirige ses notifications pour lesquelles nous faisons, mon équipe et moi-même, une analyse très poussée au cas par cas et sans délai. Si ces informations étaient avérées, nous les aurions.
Question : Il reste que la semaine dernière, un patient atteint de Covid-19 et sous hydroxychloroquine est décédé sans qu’on en sache la cause…
Réponse : Ce cas nous a été signalé et nous enquêtons à son sujet. En réalité, d’autres causes de décès sont malheureusement tout à fait possibles pour ce patient. Cependant il existe effectivement quelques cas suspects, avec des modifications de paramètres électrocardiographiques, mais souvent discutables, du fait d’autres facteurs associés ».
Ainsi, le 1er avril, le CRVP de Nice n’a pas de nouveau cas à déclarer, et par ailleurs il alerte sur le problème majeur d’interprétation de tout cas signalé qui arriverait : ce n’est pas parce qu’un patient traité avec de l’hydroxychloroquine est décédé que c’est ce médicament qui est la cause du décès. D’une part il peut avoir reçu concomitamment d’autres traitements, et d’autre part il peut décéder du fait de l’évolution de la maladie face à laquelle le médicament est impuissant passé un certain stade (ce qui est précisément le cas avec le Covid).
L’article du Monde est ainsi en réalité un cas d’école, qui pourrait être enseigné dans les centres de formation aux métiers du journalisme comme l’exemple typique de ce qu’il ne faut pas faire : travailler à charge, pour démontrer quelque chose qu’on a fixé par avance, trier dans le réel ce qui semble soutenir le préjugé de départ, surinterpréter, ne pas vérifier les informations, ne pas relever les contradictions de son informateur, ne pas chercher les arguments opposables, ne pas diversifier les sources, etc.
Un médicament utilisé depuis près de 70 ans et consommé des milliards de fois
Le paludisme (ou malaria) est une maladie infectieuse provoquée par un parasite sanguin transporté par certains moustiques. Elle décime l’humanité depuis au moins plusieurs dizaine de milliers d’années, constituant l’un de ses principaux fléaux depuis toujours. Et même si la situation sanitaire mondiale ne cesse de s’améliorer ces dernières décennies, selon le dernier rapport de l’OMS, le paludisme a touché encore près de 230 millions de personnes en 2018, principalement en Afrique sub-saharienne, et plus de 400 000 en sont mortes.
Face à une telle menace, la médecine européenne a cherché de longue date des parades. La quinine est isolée dès le début du 19ème siècle et, dans la première moitié du 20ème siècle, les chimistes en extrait diverses molécules dont le sulfate de chloroquine baptisé Résoquine. La formule finale est mise au point durant la Deuxième Guerre mondiale et elle est commercialisée à partir de 1949 sous le nom de Nivaquine. Dès cette époque, il est également bien connu que le surdosage de ces antipaludéens peut entraîner des effets secondaires importants et dangereux en termes neuromusculaires, auditifs, gastro-intestinaux, cutanés, oculaires, sanguins et cardiovasculaires (on y revient juste après). Enfin, la molécule d’hydroxychloroquine est isolée et démontrée moins dangereuse que la chloroquine, elle est commercialisée depuis 1955 (la marque la plus connue étant le Plaquenil).
Voici donc 70 ans que ces médicaments sont consommés dans le monde et on peut probablement parler d’au moins un milliard d’utilisateurs. Le Dr Drici l’indiquait à la journaliste du Monde dans l’entretien déjà cité : « sur la période 1975-avril 2020, soit quarante-cinq ans, 393 cas d’arythmies cardiaques tous azimuts, relatives à l’hydroxychloroquine ont été enregistrés au niveau mondial, et aucun cas de mort subite ».
En France, en réponse à l’interrogation de Martine Wonner, médecin et députée du Bas-Rhin, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) indiquait le 9 avril qu’environ 4 millions de boîtes de Plaquenil ont été vendues en France entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Durant ces 3 ans, la pharmacovigilance a rapporté 312 cas d’effets indésirables essentiellement oculaires et cutanéo-muqueux. Seuls 21 cas sont des effets cardiovasculaires. Enfin 3 ans, 2 décès ont été rapportés, dont 1 cas est une intoxication médicamenteuse chez un sujet prenant 6 psychotropes en plus de l’hydroxychloroquine (suicide ?). En résumé, s’agissant principalement du traitement de personnes atteintes d’une maladie chronique auto-immune grave (le lupus) qui s’attaque aux organes vitaux (entre autres le cœur), pour 4 millions de boites de médicaments, on enregistre 21 cas de troubles cardio-vasculaires et 1 ou 2 cas de décès peut-être liés à un effet du médicament.
Ceci indique que la multiplication des cas signalés aux agences régionales de pharmacovigilance depuis le mois de mars 2020 (que la presse continue de relayer à la façon du Monde, comme ici Mediapart [sic !] et le Figaro) ne procède pas de l’usage de ce médicament en lui-même, mais des maladies dont souffrent les personnes à qui il est administré officiellement à l’hôpital, dans des cas graves pour lesquels l’IHU explique depuis le début qu’il est inutile.
Des effets secondaires indésirables bien connus et étroitement surveillés à l’IHU de Marseille
Les effets secondaires néfastes de l’hydroxychloroquine (Plaquenil) sont surtout de type hépato-gastro-entérologique (nausées, vomissements, diarrhées) et ophtalmologiques (rétinopathies). Certains cas sont reportés chaque année par les centres de parmacovigilance concernant le plus souvent les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde ou de lupus (voir un exemple avec un bulletin mensuel d’un centre de pharmacovigilance d’une année récente). Bien que plus rares, les effets secondaires cardiaques de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine sont également connus de longue date, du fait cette fois de leur usage classique contre le paludisme (voir par exemple ici une synthèse sur « The cardiotoxicity of antimalarials » du programme Malaria de l’OMS, 2017). La grande revue internationale de pharmacovigilance Drug Safety a également publié en 2018 une méta-analyse de 86 articles scientifiques consacrés aux complications cardiaques engendrées par un usage intensif de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine. Tout ceci est donc classique et parfaitement connu des médecins.
L’IHU de Marseille traite les malades du Covid avec des médicaments dont le risque cardiaque, bien que rare, est très connu et très surveillé. Dans l’équipe, un professeur de l’hôpital de La Timone, spécialiste de cardiologie et de rythmologie, le Dr Jean-Claude Deharo, l’explique dans un communiqué repris sur le site de l’IHU le 1er avril :
« Nous avons pratiqué de façon systématique un électrocardiogramme à tout patient COVID-19 candidat au traitement et, en cas de prescription, nous avons répété l’électrocardiogramme après deux jours de traitement. A ce jour, les patients concernés étaient tous les patients consécutifs traités pour COVID-19 par l’équipe du Professeur Raoult, soit en ambulatoire soit en hospitalisation conventionnelle. L’intervalle QT a été mesuré sur le premier électro-cardiogramme et corrigé selon la formule de Bazett. Les recommandations étaient les suivantes :
- Autorisation de prescription si le QT corrigé était inférieur à 460 ms
- Discussion au cas par cas du bénéfice-risque en cas de QT corrigé 460 ms et 500 ms
- Contre-indication en cas de QT corrigé supérieur ou égal à 500 ms.
- Indépendamment de la valeur du QT corrigé, une liste de médicaments pouvant allonger l’intervalle QT était fournie aux prescripteurs afin d’éviter toute co-médication avec l’un de ces médicaments.
- Par ailleurs, en cas de doute, il était recommandé de contrôler la kaliémie du patient.
- Enfin une « hot-line » était mise en place entre infectiologues et cardiologues pour traiter les problèmes au plus vite.
Actuellement, sur un nombre conséquent d’électrocardiogrammes avant prescription (plus de 500), le traitement n’a été contre-indiqué que dans des cas exceptionnels. Le traitement n’a été ensuite arrêté pour raison cardio-vasculaire qu’encore plus exceptionnellement.
Le suivi strict des patients par l’équipe du Pr Raoult n’a pas révélé d’événement clinique significatif ».
Par ailleurs, le suivi des patients est particulièrement attentif et s’effectue dans la durée. Une de nos collègues (Claire B., directrice de recherche au CNRS), qui l’a suivi (ainsi que son mari) sur les conseils « pragmatiques » de leurs médecins généralistes respectifs, nous l’a raconté par courriel le 15 avril puis le 10 mai. Voici son témoignage :
« Nous avons eu plein d’examens préliminaires dès notre premier rendez-vous à l’IHU à la suite du test positif (27 mars) : prise de sang, ECG, scanner (qui ont montré que nous avions déjà des atteintes aux poumons), et un second prélèvement PCR pour l’étude épidémiologique en tant que volontaires. Suite à ces examens, un médecin nous a interrogés, puis nous a donné le traitement d’hydroxychloroquine et antibiotique. Nous l’avons pris pendant 10 jours. Les symptômes ont disparu au bout de 2 ou 3 jours, même si il restait une grosse fatigue qui a duré plus longtemps. Nous avons bénéficié d’un suivi médical que nous estimons tout à fait exceptionnel : des rendez-vous à l’IHU tous les 2 jours jusqu’à la fin du traitement (10 jours), puis un compte-rendu quotidien sur une application (ou par SMS pour mon mari). Pendant le traitement, l’IHU nous appelait par téléphone tous les deux jours, nous pouvions discuter tranquillement et demander des conseils. A la fin du traitement le suivi sur l’application s’est poursuivi quotidiennement pendant un mois. Dès qu’une réponse ne montrait pas une absence totale de symptômes, ils nous rappelaient dans les 10 minutes. Ensuite, nous avons eu encore deux appels téléphoniques de l’IUF, le dernier pour moi date du 5 mai. J’ai rempli un dernier questionnaire sur l’application le 8 mai. Ce suivi médical très prolongé et sérieux, mais aussi la communication régulière qu’il a permis d’avoir de vive voix avec les médecins ont contribué à nous rassurer et à nous aider à surmonter l’épreuve, autant qu’à vérifier notre état de santé. ».
On peut difficilement faire mieux dans la surveillance des malades et des médicaments qui leur sont administrés. Tout ceci confirme – à qui veut bien s’en enquérir honnêtement – l’extrême sérieux avec lequel est mené le traitement médical du Covid dans l’équipe du professeur Raoult.
Conclusion
Que ce traitement soit efficace ou pas est un autre débat, qui relève de la connaissance d’études scientifiques dont on a proposé récemment sur ce blog un bilan provisoire. La conclusion de l’enquête de ce jour amène, elle, à une conclusion on ne peut plus claire : dire que l’hydroxychloroquine constitue un médicament dangereux et que cela justifie sa mise à l’écart dans le traitement du Covid constitue une exagération tellement importante de la réalité qu’elle s’apparente à un mensonge d’Etat que le professeur Raoult est parfaitement fondé à dénoncer comme tel.
Ceci constitue de surcroît une infantilisation des médecins (bien comprise comme telle par ces derniers) qui connaissent parfaitement et depuis très longtemps les éventuels effets secondaires nocifs de l’hydroxychloroquine, de même que les moyens d’en contrôler et d’en prévenir la survenue.
LAURENT MUCCHIELLI
Sociologue, directeur de recherches au CNRS (Laboratoire Méditerranéen de Sociologie), www.laurent-mucchielli.org
France




















![[Exclusif] Orano versus Niger, de la fiction à la réalité Ph : DR](https://levenementniger.com/wp-content/uploads/2025/02/ORANO-GROUP-218x150.jpg)

![[Partie 2] État du Sénégal – IB Bank Togo/Burkina Faso : blanchiment d’une dette cachée de 105 milliards FCFA en créance souveraine](https://levenementniger.com/wp-content/uploads/2025/10/1-1-218x150.jpg)